 L’article ci-dessous, publié le 13 octobre 2018 sur le site Ruskline.ru est dû au Père Guennadi (Belovolov), le prêtre de la paroisse rurale de Somino, un petit village éloigné de 350 km de Saint-Pétersbourg. Il est également Directeur de l’Appartement-Mémorial de Saint Jean de Kronstadt, et fut l’acteur central de la restauration du Podvorié du Monastère de Leouchino à Saint-Pétersbourg. Homme de Dieu d’une activité débordante, il prend soin de la restauration d’anciennes église, de la construction de chapelles et d’oratoires dans les campagnes et forêts de sa paroisse. Docteur en littérature russe et spécialiste de Dostoïevski, il a rédigé de nombreux livres et brochures et participé à la réalisation d’une trilogie cinématographique sur Saint Seraphim de Vyritsa. Cette trilogie a remporté un prix dans un festival organisé à Kiev la semaine dernière et Batiouchka Guennadi en profite pour nous livrer son ressenti de la tension qui règne sur place. Read more
L’article ci-dessous, publié le 13 octobre 2018 sur le site Ruskline.ru est dû au Père Guennadi (Belovolov), le prêtre de la paroisse rurale de Somino, un petit village éloigné de 350 km de Saint-Pétersbourg. Il est également Directeur de l’Appartement-Mémorial de Saint Jean de Kronstadt, et fut l’acteur central de la restauration du Podvorié du Monastère de Leouchino à Saint-Pétersbourg. Homme de Dieu d’une activité débordante, il prend soin de la restauration d’anciennes église, de la construction de chapelles et d’oratoires dans les campagnes et forêts de sa paroisse. Docteur en littérature russe et spécialiste de Dostoïevski, il a rédigé de nombreux livres et brochures et participé à la réalisation d’une trilogie cinématographique sur Saint Seraphim de Vyritsa. Cette trilogie a remporté un prix dans un festival organisé à Kiev la semaine dernière et Batiouchka Guennadi en profite pour nous livrer son ressenti de la tension qui règne sur place. Read more
Saint Tsar Nicolas II. «En Mémoire du Dernier Tsar» (10)
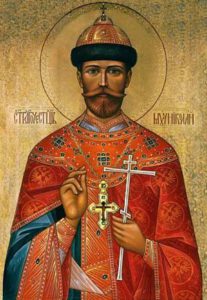
Le long texte «En mémoire du Dernier Tsar» fut publié en 1943 à Kharbine, dans le magazine «Pain céleste» ("Хлебе Небесном"). Il constitua par la suite un chapitre, aux pages 264-302, du livre Чудо русской истории. (Le Miracle de l'Histoire russe), écrit par l'Archimandrite Konstantin (Zaïtsev) (1887-1975) qui en 1949 rejoignit la communauté de Jordanville où il enseigna au Séminaire.
Il dirigea les revues ««Православная Русь» (La Rus' Orthodoxe), «Православная жизнь» (La Vie Orthodoxe), «The Orthodox Life» , et Православный путь» (La Voie Orthodoxe). Il exerça une activité pastorale d'envergure et participa amplement à la contribution majeure de l’Église Russe hors Frontières en matière de théologie, d'histoire de la Russie et d'histoire de la culture russe. A notre connaissance, ce long texte de grande valeur, parfois ardu, n'a pas été traduit et publié en français à ce jour. Il est proposé ici en entier, mais fractionné. Voici la dixième partie. Les précédentes se trouvent ici.
La Catastrophe.

«Mon père tomba suite à une brèche, mais le coup porté contre lui le fut en réalité contre la société chrétienne. Elle mourra, si les forces sociales ne s’unissent pas pour la sauver». Voilà ce qu’écrivit l’Empereur Alexandre III en 1881, encore sous l’impression fraîche de la catastrophe du premier mars, à l’Empereur François-Joseph. Le règne de l’Empereur Alexandre III fut une époque d’apaisement intérieur;la révolution se mit à couvert. Rapidement, la Russie reprit des forces, l’énergie revint. Mais il ne s’agissait que du calme avant la tempête. L’union consciente des forces sociales autour du Tsar pour sauver la «société chrétienne» n’eut pas lieu! Read more
Saint Tsar Nicolas II. «En Mémoire du Dernier Tsar» (9)
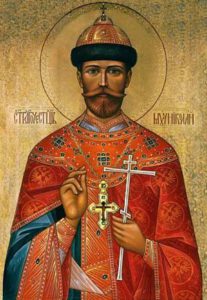
Le long texte «En mémoire du Dernier Tsar» fut publié en 1943 à Kharbine, dans le magazine «Pain céleste» ("Хлебе Небесном"). Il constitua par la suite un chapitre, aux pages 264-302, du livre Чудо русской истории. (Le Miracle de l'Histoire russe), écrit par l'Archimandrite Konstantin (Zaïtsev) (1887-1975) qui en 1949 rejoignit la communauté de Jordanville où il enseigna au Séminaire.
Il dirigea les revues ««Православная Русь» (La Rus' Orthodoxe), «Православная жизнь» (La Vie Orthodoxe), «The Orthodox Life» , et Православный путь» (La Voie Orthodoxe). Il exerça une activité pastorale d'envergure et participa amplement à la contribution majeure de l’Église Russe hors Frontières en matière de théologie, d'histoire de la Russie et d'histoire de la culture russe. A notre connaissance, ce long texte de grande valeur, parfois ardu, n'a pas été traduit et publié en français à ce jour. Il est proposé ici en entier, mais fractionné. Voici la neuvième partie. Les précédentes se trouvent ici.
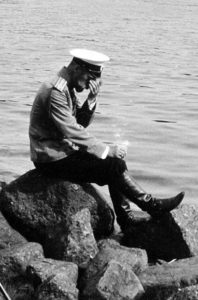 Le regard intérieur, capable de voir «spirituellement», découvrait tout autre chose. Dans cette perspective «mystique», le progrès socio-politique était chose secondaire, superficielle, parasite. Chaque succès dans cette direction, atteint au cours du règne de l’Empereur Nicolas II, furent les derniers rejaillissements d’une énorme vague spirituelle, qui retombait, et qui en son temps prit la terre de Russie, partie de rien, et l’éleva progressivement jusqu’à une gloire et une grandeur sans précédent, et maintenant la laissait s’écraser comme se dissipe l’écume. Cette dévastation spirituelle de la Russie, le Souverain la percevait directement dans son ressenti spirituel. N’était-il pas lui-même, intégralement, un fils de la Russie spirituelle? Il lui vouait tout son intérêt. Mais cet intérêt était devenu étranger, incompréhensible ou peu accessible, même à ses plus proches collaborateurs. Pour lui, par exemple, la question de la glorification de Saint Ioann de Tobolsk fut un événement d’une importance exceptionnelle, alors que pour l’artisan principal de la mise en œuvre des réformes stolypiniennes, V.I. Gourko, un homme de droite intelligent, honnête, ce n’était qu’une futilité dont la défense se résumait à une manifestation de l’arbitraire mesquin du Tsar! Ce fut «à tout le moins, une décision arbitraire» qui provoqua seulement, selon Gourko, la juste indignation «tant de la société que des hiérarques de l’Église». Read more
Le regard intérieur, capable de voir «spirituellement», découvrait tout autre chose. Dans cette perspective «mystique», le progrès socio-politique était chose secondaire, superficielle, parasite. Chaque succès dans cette direction, atteint au cours du règne de l’Empereur Nicolas II, furent les derniers rejaillissements d’une énorme vague spirituelle, qui retombait, et qui en son temps prit la terre de Russie, partie de rien, et l’éleva progressivement jusqu’à une gloire et une grandeur sans précédent, et maintenant la laissait s’écraser comme se dissipe l’écume. Cette dévastation spirituelle de la Russie, le Souverain la percevait directement dans son ressenti spirituel. N’était-il pas lui-même, intégralement, un fils de la Russie spirituelle? Il lui vouait tout son intérêt. Mais cet intérêt était devenu étranger, incompréhensible ou peu accessible, même à ses plus proches collaborateurs. Pour lui, par exemple, la question de la glorification de Saint Ioann de Tobolsk fut un événement d’une importance exceptionnelle, alors que pour l’artisan principal de la mise en œuvre des réformes stolypiniennes, V.I. Gourko, un homme de droite intelligent, honnête, ce n’était qu’une futilité dont la défense se résumait à une manifestation de l’arbitraire mesquin du Tsar! Ce fut «à tout le moins, une décision arbitraire» qui provoqua seulement, selon Gourko, la juste indignation «tant de la société que des hiérarques de l’Église». Read more
Saint Tsar Nicolas II. «En Mémoire du Dernier Tsar» (8)
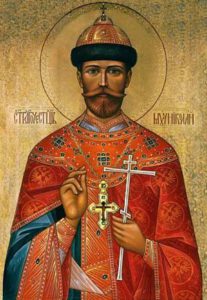
Le long texte «En mémoire du Dernier Tsar» fut publié en 1943 à Kharbine, dans le magazine «Pain céleste» ("Хлебе Небесном"). Il constitua par la suite un chapitre, aux pages 264-302, du livre Чудо русской истории. (Le Miracle de l'Histoire russe), écrit par l'Archimandrite Konstantin (Zaïtsev) (1887-1975) qui en 1949 rejoignit la communauté de Jordanville où il enseigna au Séminaire.
Il dirigea les revues ««Православная Русь» (La Rus' Orthodoxe), «Православная жизнь» (La Vie Orthodoxe), «The Orthodox Life» , et Православный путь» (La Voie Orthodoxe). Il exerça une activité pastorale d'envergure et participa amplement à la contribution majeure de l’Église Russe hors Frontières en matière de théologie, d'histoire de la Russie et d'histoire de la culture russe. A notre connaissance, ce long texte de grande valeur, parfois ardu, n'a pas été traduit et publié en français à ce jour. Il est proposé ici en entier, mais fractionné. Voici la huitième partie. Les précédentes se trouvent ici.
 C’était le cas de Stolypine. Il ressentait parfois dans sa grande âme ce malaise qui soufflait sur la Russie, mais en tant qu’homme confronté aux affaires et aux luttes pratiques, il n’approfondit pas ces pressentiments, les chassa hors de lui et continua son travail enthousiaste sur le seul plan politique. Et ici, évidemment, il n’était pas à l’unisson avec le Souverain… La position de Stolypine était claire. Read more
C’était le cas de Stolypine. Il ressentait parfois dans sa grande âme ce malaise qui soufflait sur la Russie, mais en tant qu’homme confronté aux affaires et aux luttes pratiques, il n’approfondit pas ces pressentiments, les chassa hors de lui et continua son travail enthousiaste sur le seul plan politique. Et ici, évidemment, il n’était pas à l’unisson avec le Souverain… La position de Stolypine était claire. Read more
L’Ukraine à vif.
 Une fois n’est pas coutume, mais les circonstances rares générées par le projet d’élaboration, en Petite Russie et aux alentours, d’un pseudo-exarchat rassemblant des schismatiques de tous bords sous l’égide du Patriarcat Œcuménique, ont tendance à faire sortir les Orthodoxes de leurs gonds, même ceux qui, comme moi sont des Chrétiens Orthodoxes membres d’une Métropole “grecque” d’Europe occidentale, dépendante du Patriarcat Œcuménique. Sortons donc de nos gonds et cette fois, l’habituelle traduction sera remplacée par une petite revue des publications récentes sur le web, légèrement commentée.
Une fois n’est pas coutume, mais les circonstances rares générées par le projet d’élaboration, en Petite Russie et aux alentours, d’un pseudo-exarchat rassemblant des schismatiques de tous bords sous l’égide du Patriarcat Œcuménique, ont tendance à faire sortir les Orthodoxes de leurs gonds, même ceux qui, comme moi sont des Chrétiens Orthodoxes membres d’une Métropole “grecque” d’Europe occidentale, dépendante du Patriarcat Œcuménique. Sortons donc de nos gonds et cette fois, l’habituelle traduction sera remplacée par une petite revue des publications récentes sur le web, légèrement commentée.
Tout d’abord, notons que la provocation d’une nouvelle “Église autocéphale” s’est transformée subrepticement mais rapidement en un nouvel “exarchat” sous l’omophore de Constantinople, au grand dam, sans doute, de l’ex-clerc Philarète. Cela ressemble à un plan soigneusement mûri. Notons ensuite que tout cela coïncide avec l’assassinat récent du Président de l’ex-République Populaire de Donetsk, (devenue Malorossia en 2017) Alexandre Zakhartchenko, qui aurait vraisemblablement pu jouer un rôle dans certains développements de la situation.
Restons en Petite Russie avec Le Journal d’un Orthodoxe Ordinaire, puisque Gogol était malorussien, avec “Bon ! Eh bien, on relira un peu Gogol…” : « Certaines gens ont la rage de faire des vilenies à leur prochain, souvent sans aucune raison. Un monsieur haut gradé, des plus décoratifs, plaque à la poitrine, vous serre la main, vous tient des propos élevés, pour aussitôt vous faire en public une crasse, une crasse plus digne d’un gratte-papier que d’un monsieur portant plaque à la poitrine et tenant des propos élevés ; vous demeurez stupide, et ne pouvez que hausser les épaules. » Lire la suite sur le site.
Nous avions proposé il y a peu une analyse de la situation par Vladika Théodose, Vicaire de Sa Béatitude Mgr Onufre : “Ukraine: le repentir plutôt que l’autocéphalie comme méthode de guérison du schisme” « Vladika, une première question, très importante dans le contexte du jubilé qui vient de se dérouler et des événements intervenus ces derniers temps concernant l’Église Orthodoxe d’Ukraine : Le lien entre l’Église d’Ukraine et le Patriarcat de Moscou sont-ils réellement profonds, historiquement et du point de vue actuel? Concrètement, les Églises d’Ukraine et de Russie sont-elles des Églises différentes, presque antagonistes, comme disent les schismatiques?» Lire la suite sur le site.
Sur le site Russie Politics, de Carine Bechet Golovko, particulièrement recommandable pour ses analyses de la situation politique en Russie : L’Ukraine au bord d’une guerre de religion qui semble servir certains intérêts : «Le rythme des agressions contre l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou s’est accéléré depuis le Maïdan en 2014. En 4 ans, 50 églises ont été transférées par la violence et en toute illégalité du Patriarcat de Moscou à L’Église renégate de Filaret. En ce sens, les démarches du Patriarche de Constantinople ne peuvent qu’aggraver la situation, ce que vient de démontrer cette dernière prise par la violence, hier, de l’église orthodoxe de la région de Ivano-Frankovsk, faisant plusieurs blessés au passage. Dans tous les cas de ce genre, l’on note une collusion entre le groupe extrémiste Secteur droit, les forces de l’ordre et les renégats. Et aucune réaction sérieuse de la communauté internationale, qui laisse ces crimes se dérouler dans la plus grande indifférence. A moins que cela ne corresponde à certains intérêts». Lire la suite sur le site.
Orthodoxologie propose la traduction d’une analyse de Dimitry Marchenko, journaliste, rédacteur du portail “Vie Orthodoxe” («Православная жизнь»), qui vit à Kiev : Dimitry Martchenko : L’Ukraine au seuil de la catastrophe: ce que veulent vraiment les combattants de l’autocéphalie : «Les initiatives douteuses du Phanar en Ukraine deviennent de plus en plus déroutantes ; mais le Patriarche Bartholomée est-il vraiment libre dans ses actions ?
Dans de nombreuses publications consacrées à l’autocéphalie ukrainienne et aux Tomos correspondants, l’idée est exprimée que le Phanar, dans le but d’affirmer sa domination et son exclusivité dans le monde orthodoxe, a décidé de profiter d’une situation opportune en Ukraine, en l’utilisant comme une occasion de se déclarer “chef canonique” de toute l’orthodoxie ukrainienne, comme un leader “qui viendra et remettra de l’ordre”[1]. C’est précisément cet “ordre” que, selon lui, l’Église orthodoxe russe n’a pas été en mesure d’apporter sur son territoire canonique depuis plus de 25 ans.» Lire la suite sur le site.
Parlons d’Orthodoxie, blog de discussion du diocèse de Chersonèse du Patriarcat de Moscou titre “Le Grand Jeu anti-orthodoxe” son analyse qui résume les points-clés de la situation : «La manœuvre de Constantinople apparaît très astucieuse : soumis à une très forte pression nord-américaine pour, selon eux, “libérer l’Église ukrainienne de la main mise russe”, il n’accorde pas l’autocéphalie aux juridictions schismatique (pseudo-patriarcat de Kiev/PK et Église orthodoxe autocéphale ukrainienne/EOAU aussi appelée ‘Église ukrainienne autocéphale’ (1)), mais va susciter la formation d’une nouvelle entité sous son obédience directe». Lire la suite sur le site.
Saint Materne avait proposé, moins récemment, mais très opportunément un rappel de la Grande Duchesse Maria Vladimirovna de Russie : Le pouvoir dans l’Église et le schisme actuel «Les Canons qui confèrent à l’Église de Constantinople certains pouvoirs d’arbitrage des différends et de coordination des diverses fonctions dans l’Église découlent entièrement de conditions qui n’existent plus depuis plus de 500 ans.» Lire la suite sur le site.
Sous le titre Des prières pour monseigneur Onuphre , Chroniques de Pereslavl mettent en avant la noble personne de Vladika Onuphre, mais proposent également une réaction venant de la Sainte Montagne, celle du Père Higoumène du Monastère de Saint Paul qui soutient sans équivoque la pleine canonicité de l’Église Orthodoxe d’Ukraine dirigée par Vladika Onuphre. La rareté des réactions venant de l’Athos nous laisse un certain sentiment d’amertume. Pardon, Seigneur… «La situation générale dans notre monde se dégrade à vitesse vertigineuse. Outre la situation écologique absolument, fantastiquement désastreuse, il n’est pas de jours sans viols, coups de couteaux ou lynchages en Europe, de la part d’envahisseurs que tout encourage à se conduire comme des cochons, ou plus simplement, comme des pirates, comme les Huns, les Turcs, les Mongols, les Sarrazins. Seulement autrefois, les seigneurs mouraient pour nous, aujourd’hui, ce sont eux qui nous livrent. Quoique en l’occurrence, le mot de «seigneur» est beaucoup trop noble pour la bande d’usuriers, de mafieux et de pervers à l’œuvre de façon transnationale.» Lire la suite sur le site.
L’information fournie par les articles ci-dessus quand à l’inexorable montée de la violence engendrée par la mise en œuvre de la décision en cause et l’effroyable sentiment de division qui en découle rend absolument stupéfiant et surréaliste le titre de l’article proposé par Orthodoxie.com : Le patriarche œcuménique : « Nombreux sont ceux qui me prennent pour cible, mais j’ai la conscience tranquille ». «Recevant le jeudi 27 septembre, au Phanar, le métropolite de Patras, Chrysostome, et un groupe de fidèles de son diocèse, le patriarche œcuménique Bartholomée a évoqué le droit et le devoir du patriarcat œcuménique de proclamer l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine». Lire la suite sur le site.
Comment peut-on avoir la conscience tranquille en pareilles circonstances, quand les combats ont commencé, quand s’annonce le pillage, quand l’ennemi s’active avec rage… avoir la conscience tranquille… Et le sang, s’il coule, sur qui retombera-t-il?
Avons-nous prié suffisamment depuis des années? Prions-nous suffisamment? Notre cœur saigne-t-il pour nos frères et sœurs de Petite Russie, de Syrie, d’Irak, d’Égypte, de Chine et de tous les endroits où ils sont persécutés? Puissent les prières de la Très Sainte Mère de Dieu, l’intercession et les torrents de larmes de tous les Saints et nos faibles prières être entendues par notre Seigneur Jésus Christ et la paix ramenée dans les foyers de discorde et particulièrement dans l’Église une, sainte catholique et apostolique… Amen
Saint Tsar Nicolas II. «En Mémoire du Dernier Tsar» (7)
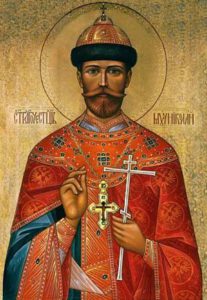
Le long texte «En mémoire du Dernier Tsar» fut publié en 1943 à Kharbine, dans le magazine «Pain céleste» ("Хлебе Небесном"). Il constitua par la suite un chapitre, aux pages 264-302, du livre Чудо русской истории. (Le Miracle de l'Histoire russe), écrit par l'Archimandrite Konstantin (Zaïtsev) (1887-1975) qui en 1949 rejoignit la communauté de Jordanville où il enseigna au Séminaire.
Il dirigea les revues ««Православная Русь» (La Rus' Orthodoxe), «Православная жизнь» (La Vie Orthodoxe), «The Orthodox Life» , et Православный путь» (La Voie Orthodoxe). Il exerça une activité pastorale d'envergure et participa amplement à la contribution majeure de l’Église Russe hors Frontières en matière de théologie, d'histoire de la Russie et d'histoire de la culture russe. A notre connaissance, ce long texte de grande valeur, parfois ardu, n'a pas été traduit et publié en français à ce jour. Il est proposé ici en entier, mais fractionné. Voici la septième partie. Les précédentes se trouvent ici.

Ayant créé un système de représentation populaire, le Tsar admit ce nouvel ordre des choses uniquement comme une modification technique du mécanisme supérieur de gouvernement. Homme d’une loyauté extrême et libre de toute passion ou attirance personnelle, il observa, avec un scrupule exceptionnel, les règles organisant le fonctionnement de la Douma d’État, tout comme il observait la loi en toutes circonstances et dans tous les domaines. Mais en son for intérieur, ce mécanisme lui demeura étranger, sans précédent au cours de l’histoire russe. On trouve le témoignage clair de cela dans la correspondance du Tsar avec le Ministre de l’Intérieur N.A. Maklakov, publiée en Russie à l’époque soviétique. Tentant de monter le Tsar contre la Douma, en 1913, Maklakov lui demanda de prendre la décision de la dissoudre s’il ne parvenait pas à la faire fonctionner dans les limites de la légalité. Rien ne sortit des réflexions de Maklakov, car il se heurta à une opposition unie et décidée au sein du Conseil des Ministres. Mais il est curieux que dans sa correspondance avec Maklakov, le Tsar exprimât pleinement son désaccord vis-à-vis de l’ordre régnant de l’État. Il écrivit: «Je considère également nécessaire et de bon ton que le Conseil des Ministres examine sans retard mon idée persistante de modifier l’article instituant la Douma d’État, et en vertu duquel, si la Douma n’est pas d’accord avec les modifications du Conseil d’État, et ne soutient pas un projet de loi, celui-ci est réduit à néant. En l’absence de Constitution, cela est un total non-sens. La soumission des opinions argumentées de la majorité et de la minorité au choix et à la ratification du Souverain serait un bénéfique retour à un cours plus paisible de l’activité législative, et en outre, conforme à l’esprit russe». Tel était l’avis «personnel» du Tsar, sur lequel, évidemment, il n’insista pas, car il était dépourvu de tout esprit mesquin et d’entêtement, dont il était constamment accusé. Au contraire, il couvrit, étonnamment, avec sollicitude de son haut patronage, la remarquable, à bien des égards, «Constitution russe» trouvant son expression suprême dans les Lois Fondamentales du 23 avril – chef-d’œuvre de droit administratif!- Mais cela ne pouvait en aucun cas signifier pour lui qu’il se sentait, toujours et en toutes circonstances, obligé de se soumettre à cette forme exprimée dans les actes législatifs «constitutionnels». Car lui, et lui seul, continuait à porter, même dans le cadre des nouvelles «lois fondamentales», la responsabilité devant Dieu du destin du peuple de Russie! Aucun pouvoir sur terre n’était habilité à priver le Tsar du droit et de lui ôter la responsabilité de se sentir arbitre suprême dans les décisions définitives que réclament des circonstances exceptionnelles. Lorsque l’Empereur allemand lui proposa, en vue de minimiser sa responsabilité dans l’accord de Portsmouth, de soumettre celui-ci à la ratification de la Douma, le Tsar répondit qu’il assumait la responsabilité de ses décisions devant Dieu et devant l’histoire…
 Le Souverain continuait à se considérer comme l’arbitre devant lequel aucun appel n’était possible, même en politique intérieure. C’est précisément cette disposition d’esprit du Tsar qui généra l’Acte 3 de juin 1917, qui, pris en violation de la «constitution», sorti la Russie de l’impasse où l’avait menée l’incapacité de fonctionnement de la Douma. «Par le pouvoir sur notre peuple que le Seigneur donna au Tsar, devant Son Trône, nous répondrons du destin de la Puissance qu’est la Russie», lisons-nous dans le manifeste du 3 juin! Il arrivait également au Tsar de prendre sur sa conscience certaines décisions concernant des questions relatives à l’Église, et dans ces cas, il ne se sentait pas formellement lié par les décisions du Saint Synode. Un témoin bien informé, Jévakhov, a écrit qu’au cours de son règne, le Tsar manifesta seulement à trois reprises sa volonté d’Autocrate à l’égard du Saint Synode. La première fois, ce fut à l’occasion de la glorification de Saint Ioasaf de Belgorod, en 1910. Attendant avec impatience que le Synode détermine le moment de la cérémonie officielle, le Tsar ne s’arrogea pas le droit d’interférer dans les travaux du Synode en lui demandant de se presser. Mais lorsque le Synode déclara qu’il état nécessaire de postposer cette cérémonie, le Tsar marqua son désaccord avec les conclusions de l’Ober-procureur et du Synode et fixa lui-même le délai. Il manifesta une deuxième fois sa volonté dans le cas de la glorification de Saint Jean Métropolite de Tobolsk. Et finalement, la troisième fois survint lors de la décision concernant le Métropolite Vladimir de Kiev… Il y aurait eu, toutefois, d’autres cas semblables, que Jévakhov ne releva pas. Ainsi, Gourko mentionne l’abrogation par le Souverain du déplacement du Hiéromoine Iliodore, prescrit par le Synode, abrogation qui, selon Gourko, produisit une impression pénible sur le Métropolite Antoine. Nous ne mentionnerons pas deux autres cas individuels; dans pareilles circonstances, les différences d’opinions et les évaluations divergentes sont toujours possibles.
Le Souverain continuait à se considérer comme l’arbitre devant lequel aucun appel n’était possible, même en politique intérieure. C’est précisément cette disposition d’esprit du Tsar qui généra l’Acte 3 de juin 1917, qui, pris en violation de la «constitution», sorti la Russie de l’impasse où l’avait menée l’incapacité de fonctionnement de la Douma. «Par le pouvoir sur notre peuple que le Seigneur donna au Tsar, devant Son Trône, nous répondrons du destin de la Puissance qu’est la Russie», lisons-nous dans le manifeste du 3 juin! Il arrivait également au Tsar de prendre sur sa conscience certaines décisions concernant des questions relatives à l’Église, et dans ces cas, il ne se sentait pas formellement lié par les décisions du Saint Synode. Un témoin bien informé, Jévakhov, a écrit qu’au cours de son règne, le Tsar manifesta seulement à trois reprises sa volonté d’Autocrate à l’égard du Saint Synode. La première fois, ce fut à l’occasion de la glorification de Saint Ioasaf de Belgorod, en 1910. Attendant avec impatience que le Synode détermine le moment de la cérémonie officielle, le Tsar ne s’arrogea pas le droit d’interférer dans les travaux du Synode en lui demandant de se presser. Mais lorsque le Synode déclara qu’il état nécessaire de postposer cette cérémonie, le Tsar marqua son désaccord avec les conclusions de l’Ober-procureur et du Synode et fixa lui-même le délai. Il manifesta une deuxième fois sa volonté dans le cas de la glorification de Saint Jean Métropolite de Tobolsk. Et finalement, la troisième fois survint lors de la décision concernant le Métropolite Vladimir de Kiev… Il y aurait eu, toutefois, d’autres cas semblables, que Jévakhov ne releva pas. Ainsi, Gourko mentionne l’abrogation par le Souverain du déplacement du Hiéromoine Iliodore, prescrit par le Synode, abrogation qui, selon Gourko, produisit une impression pénible sur le Métropolite Antoine. Nous ne mentionnerons pas deux autres cas individuels; dans pareilles circonstances, les différences d’opinions et les évaluations divergentes sont toujours possibles.
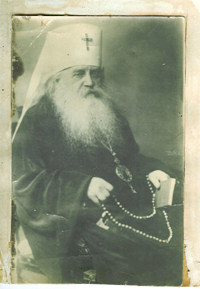 Pour ce qui concerne la glorification des saints, on est forcé d’admettre que le Tsar avait toujours, sur le plan spirituel, un temps d’avance sur le Synode, influencé par les opinions mondaines bien connues et caractérisées par leur indifférence et leur scepticisme en matière de foi. Ce fut le cas particulièrement lors du report de la glorification du Métropolite Ioann, que le Synode motiva par la nécessité de prendre en compte les implications politiques. Pour ce qui concerne ces dernières, le Tsar pouvait, quoi qu’il en soit, se considérer plus compétent que le Synode! En 1930, le Métropolite Antoine (de Kiev et de Galicie) qualifia le sens de la position du Tsar en matière de glorification des saints comme suit: «Le règne de l’Empereur Nicolas II correspondit à une réelle ouverture vis-à-vis de l’invention des reliques des saints et de la glorification de ceux-ci. Les choses étaient devenues très délicates à ce propos en Russie les derniers temps, suite à ce qui se produisit lors de l’invention des reliques de Saint Tikhon de Zadonsk. L’événement déclencha un tel enthousiasme populaire et tant de miracles se produisirent, que se répandit en Russie le bruit selon lequel l’Empereur Alexandre II aurait dit qu’il n’y aurait plus de nouveaux saints en Russie. Je ne crois pas que le Souverain ait pu prononcer pareille phrase, mais le simple fait que cette rumeur se répandit caractérise à souhait l’opinion publique de l’époque. Pendant le règne de l’Empereur Nicolas II, on procéda à l’invention des reliques de Saint Théodose de Tchernigov, en 1896, de Saint Seraphim de Sarov, en 1930, de Saint Ioasaph de Belgorod, en 1911, de Saint Ioann de Tobolsk, de Sainte Anne de Kachine et de Saint Pitirim de Tambov. Je me souviens d’une des sessions du Synode au cours de laquelle un hiérarque fit remarquer qu’on ne pouvait continuer indéfiniment à glorifier des saints. Les regards des participants se tournèrent vers moi et je répondis: «Si nous croyons en Dieu, nous devons nous réjouir de la glorification des Saints». De ce point de vue, conclut Vladika, d’autant plus grande était la dévotion du Souverain qui était quasiment le premier à prendre les décisions en ce domaine».
Pour ce qui concerne la glorification des saints, on est forcé d’admettre que le Tsar avait toujours, sur le plan spirituel, un temps d’avance sur le Synode, influencé par les opinions mondaines bien connues et caractérisées par leur indifférence et leur scepticisme en matière de foi. Ce fut le cas particulièrement lors du report de la glorification du Métropolite Ioann, que le Synode motiva par la nécessité de prendre en compte les implications politiques. Pour ce qui concerne ces dernières, le Tsar pouvait, quoi qu’il en soit, se considérer plus compétent que le Synode! En 1930, le Métropolite Antoine (de Kiev et de Galicie) qualifia le sens de la position du Tsar en matière de glorification des saints comme suit: «Le règne de l’Empereur Nicolas II correspondit à une réelle ouverture vis-à-vis de l’invention des reliques des saints et de la glorification de ceux-ci. Les choses étaient devenues très délicates à ce propos en Russie les derniers temps, suite à ce qui se produisit lors de l’invention des reliques de Saint Tikhon de Zadonsk. L’événement déclencha un tel enthousiasme populaire et tant de miracles se produisirent, que se répandit en Russie le bruit selon lequel l’Empereur Alexandre II aurait dit qu’il n’y aurait plus de nouveaux saints en Russie. Je ne crois pas que le Souverain ait pu prononcer pareille phrase, mais le simple fait que cette rumeur se répandit caractérise à souhait l’opinion publique de l’époque. Pendant le règne de l’Empereur Nicolas II, on procéda à l’invention des reliques de Saint Théodose de Tchernigov, en 1896, de Saint Seraphim de Sarov, en 1930, de Saint Ioasaph de Belgorod, en 1911, de Saint Ioann de Tobolsk, de Sainte Anne de Kachine et de Saint Pitirim de Tambov. Je me souviens d’une des sessions du Synode au cours de laquelle un hiérarque fit remarquer qu’on ne pouvait continuer indéfiniment à glorifier des saints. Les regards des participants se tournèrent vers moi et je répondis: «Si nous croyons en Dieu, nous devons nous réjouir de la glorification des Saints». De ce point de vue, conclut Vladika, d’autant plus grande était la dévotion du Souverain qui était quasiment le premier à prendre les décisions en ce domaine».
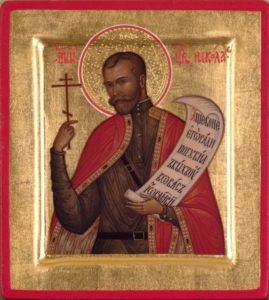 Le matériel que nous avons présenté suffit à prendre la mesure de la nature de la divergence de pensée et de sentiment entre le Tsar et la société russe, dans la mesure où il s’agissait d’une divergence dans la conception et l’évaluation de l’essence du pouvoir impérial et des prérogatives de celui-ci en Russie. Mais ce faisant, nous n’avons pas encore résolu la question dans son ensemble. Nous n’avons encore rien dit de l’essentiel; nous ne l’avons pas même effleuré! Comme nous le savons, on constatait ces différences de pensées et de sentiments non seulement entre le Tsar et les gens indifférents à l’Église (nous ne voulons pas même parler de ceux qui étaient hostiles à celle-ci), mais entre lui et les gens proches de l’Église, soumis au Tsar, parfois jusqu’à la dernière goutte de leur sang! De ce qui vient d’être dit, on peut comprendre pourquoi le Tsar et les Kadets, ni même le Tsar et Witte, ne pouvaient trouver langue commune. Y eut-il réellement langue commune entre le Tsar et Stolypine, que le Souverain respectait et appréciait sincèrement et profondément, un homme qui de son côté prouva son dévouement au Tsar par ses activités et par sa mort elle-même? La même divergence essentielle de pensée et de sentiment, à un degré évidemment moindre, était perceptible entre Stolypine et le Tsar. Nous abordons ici une énigme dont la solution apparaîtra seulement dans des événements ultérieurs, inaccessibles à ceux qui vécurent au cours de son règne. En même temps, nous approchons des éléments que, bien souvent, les gens, même ceux qui ne sont pas très éloignés de l’Église, collent une étiquette du genre «humeur mystique», «mysticisme», etc. Effectivement, le Tsar était soumis à ce genre «d’humeur». En d’autres termes, il était capable de connaître et de voir ce que ne pouvaient connaître ni voir les gens moins doués spirituellement et menant une vie moins spirituelle.
Le matériel que nous avons présenté suffit à prendre la mesure de la nature de la divergence de pensée et de sentiment entre le Tsar et la société russe, dans la mesure où il s’agissait d’une divergence dans la conception et l’évaluation de l’essence du pouvoir impérial et des prérogatives de celui-ci en Russie. Mais ce faisant, nous n’avons pas encore résolu la question dans son ensemble. Nous n’avons encore rien dit de l’essentiel; nous ne l’avons pas même effleuré! Comme nous le savons, on constatait ces différences de pensées et de sentiments non seulement entre le Tsar et les gens indifférents à l’Église (nous ne voulons pas même parler de ceux qui étaient hostiles à celle-ci), mais entre lui et les gens proches de l’Église, soumis au Tsar, parfois jusqu’à la dernière goutte de leur sang! De ce qui vient d’être dit, on peut comprendre pourquoi le Tsar et les Kadets, ni même le Tsar et Witte, ne pouvaient trouver langue commune. Y eut-il réellement langue commune entre le Tsar et Stolypine, que le Souverain respectait et appréciait sincèrement et profondément, un homme qui de son côté prouva son dévouement au Tsar par ses activités et par sa mort elle-même? La même divergence essentielle de pensée et de sentiment, à un degré évidemment moindre, était perceptible entre Stolypine et le Tsar. Nous abordons ici une énigme dont la solution apparaîtra seulement dans des événements ultérieurs, inaccessibles à ceux qui vécurent au cours de son règne. En même temps, nous approchons des éléments que, bien souvent, les gens, même ceux qui ne sont pas très éloignés de l’Église, collent une étiquette du genre «humeur mystique», «mysticisme», etc. Effectivement, le Tsar était soumis à ce genre «d’humeur». En d’autres termes, il était capable de connaître et de voir ce que ne pouvaient connaître ni voir les gens moins doués spirituellement et menant une vie moins spirituelle.

Et c’est précisément cette prédisposition, que le Souverain fit mûrir en une «supra-conscience mystique» qui le rendit relativement indifférent à tout ce qui brillait dans les domaines culturel, économique et politique, qui pourtant embellit son règne et pour lesquels œuvrèrent avec tant d’enthousiasme, avec tant de ferveur authentique, certains de ses proches, de ses collaborateurs, Stolypine plus que tous les autres. On notera d’ailleurs que Stolypine, selon certains témoins le connaissant de près, n’était pas complètement étranger à une perception «mystique» de l’abîme qui menaçait d’engloutir la Russie. Ce sentiment était, à des degrés différents, inhérent à quasiment tous les conservateurs notables, quelque différentes que fussent leur caractéristiques psychologiques ou intellectuelles. Et il était le fondement du scepticisme envers les résultats positifs du développement civil du pays, exprimé avec alacrité par Pobedonovtsev et Leontiev. Il était inhérent à différentes doses à la majorité de ceux qui soutenaient les piliers de la «réaction». Par ailleurs, cette crainte, ils la ressentaient la plupart du temps de façon tout à fait instinctive, sans chercher à en articuler les arguments, et se retrouvaient parfois en complète contradiction avec les positions politiques qu’ils défendaient. (A suivre)
Traduit du russe